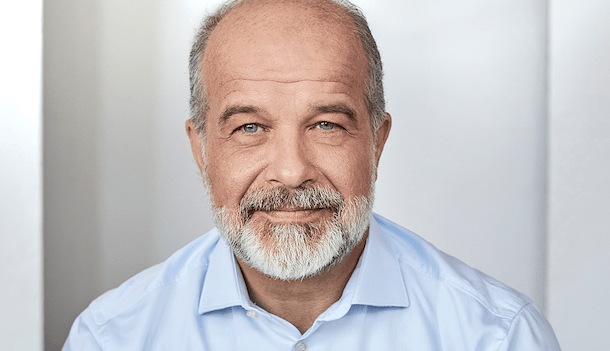LittératureDans la peau de
Crédit photo : Seana Pasic
Raymonde, nous sommes ravis d’échanger avec vous aujourd’hui! Nous avons appris que, petite, vous avez vécu un an avec vos parents dans un camp de bûcherons: cela semble avoir marqué le cours de votre existence, puisque vous avez déjà publié plusieurs livres en lien avec cette thématique! Qu’est-ce qui vous a tant fascinée dans ce mode de vie et cet environnement?
«L’image véhiculée dans les séries télévisées — ou par quelques romans — n’avait rien à voir avec les hommes de mon village qui allaient bûcher chaque année. Cette méconnaissance devait, à mon avis, être dénoncée. Il n’y avait pas d’alcool dans les camps. Ces travailleurs devaient être débrouillards, disciplinés et tenaces, autant pour l’abattage des arbres, le charroyage, que la drave au printemps.»
«Ils vivaient plusieurs mois loin des leurs. Ils dormaient dans des camps de bois ronds et se contentaient du strict nécessaire. Ils savaient en partant qu’il n’y aurait pas de viande avant les grands froids. Et souvent, ils mangeaient bien. C’était une organisation incroyable, dont les acteurs étaient fiers.»
«C’est d’abord en voulant rendre hommage à mes parents que j’ai réalisé que des Roger et des Colette, il y en avait partout au Québec. L’engouement, la reconnaissance et l’émotion des spectateurs lors de nos présentations sur la vie dans les chantiers m’ont touchée. Ils voulaient raconter, eux aussi, préserver la mémoire, participer. Certains ont pleuré, d’autres relevaient la tête fièrement. Plus je découvrais leur quotidien, plus ils devenaient mes héros.»
Le 22 février, votre livre Il était une fois des draveurs est justement paru aux éditions du Septentrion. Vous y partagez leurs témoignages, en plus de décrire leurs manœuvres dans les barges et sur la rive. Pourriez-vous, dans vos propres mots, nous expliquer en quoi consistaient leur quotidien et leurs tâches, à l’époque?
«Les draveurs devaient prévenir la formation d’embâcles et les défaire quand il y en avait. Ils se divisaient habituellement en deux groupes. Les gars de boat travaillaient en équipe de 4 ou 6 dans de grosses barges. Ils devaient connaître la rivière et ses pièges. D’autres équipes restaient sur les rives des deux côtés de la rivière. Ils se déplaçaient à pied. Ils remettaient dans le courant toutes les pitounes coincées par des branches, ou qui avaient dérivé dans des baies. Ils travaillaient à l’épaule ou avec des câbles pour les billots trop lourds. Pour les deux groupes, il leur fallait une grande force physique et des nerfs solides.»
«Les draveurs campaient dans des tentes de toile sur le bord des rivières. Les journées pluvieuses ne les arrêtaient pas. Ils remettaient des vêtements trempés de la veille. Ils avaient droit en moyenne à quatre repas par jour. Le cook cuisinait souvent sur un feu. Les draveurs travaillaient d’une noirceur à l’autre, soit plus de douze heures par jour, sept jours par semaine. Ils devaient agir rapidement pour profiter de la crue des eaux. Ils avaient parfois peur, parfois froid. Ils vivaient avec un sentiment d’urgence constant.»
Vous avez notamment interviewé des maîtres-draveurs comme Salomon, Vianney, Roger et Gaspard. Comment êtes-vous tombée sur eux, et comment se sont passés vos échanges?
«Le fait d’avoir commencé mes recherches au début des années 1980 m’a permis de rencontrer de vieux draveurs qui avaient fait la drave de billots, avant 1930. Salomon Lépine, maître-draveur, était un témoin incroyable. Impossible de l’oublier quand il parlait “de la clé qu’il entendait souffler” pour parler du son à peine perceptible de la jam prête à céder.»
«J’ai cherché les témoignages de draveurs qui me permettaient de brosser un tableau assez complet et réaliste du métier. J’ai parfois été guidée par mes parents ou par d’autres draveurs. Ils se connaissaient et se respectaient entre eux. Leurs propos ont une grande importance pour connaître cette réalité inimaginable aujourd’hui. Leurs anecdotes ont autant d’importance que les photos. Il était nécessaire de leur laisser du temps pour que leurs souvenirs reviennent.»
«Il m’a été impossible de ne pas être profondément touchée par la difficulté de leur travail, leurs conditions de vie difficiles ou leur peine face à des disparus qu’ils ont cherchés en vain. C’est avec une grande admiration que je les ai écoutés.»
Et alors, outre les témoignages recueillis, comment vous êtes-vous renseignée sur la profession en tant que telle? Par exemple, on aimerait savoir sur quels types de documents vous vous êtes basée pour brosser ce portrait complet et original!
«Il était essentiel de trouver des documents pour appuyer les témoignages des draveurs que j’ai rencontrés. Les livres de Normand Lafleur ont été d’une grande importance, tant pour les outils que pour les techniques utilisées par les draveurs.»
«Les écrits de Gilles Rivest de Saint-Michel-des-Saints, qui a fait un travail d’archives appuyé de journaux régionaux — comme L’Étoile du Nord — sur le barrage du Taureau, m’ont permis de confirmer les dires d’un témoin comme Vianney. Une photo et un article de journal peuvent parfois compléter l’information ou une date.»
«Quelques films ont aussi été produits sur le sujet. La correspondance avec certaines municipalités, comme Charlemagne ou Saint-Donat, a été d’un précieux secours. La photo de la chargeuse appuie le témoignage de Roger sur le chargement. Un document produit par la Compagnie de flottage du Saint-Maurice a été une source intéressante d’informations du travail de la compagnie. C’est avec intérêt que j’ai lu d’autres livres sur la drave.»
Pensez-vous un jour vous pencher sur un autre aspect en lien avec la vie de bûcheron et, si oui, quel serait-il?
«Au début des années 1940, plus de 30 000 bûcherons partaient abattre des arbres pour l’hiver. L’industrie des papetières leur offrait l’opportunité de gagner de l’argent sonnant. On en avait besoin pour payer un médecin ou améliorer un bâtiment sur la ferme. Les terres agricoles qu’on leur avait octroyées n’ont pas tenu leurs promesses.»
«L’historien Christian Morissonneau parle dans ses écrits de la Matawinie comme d’une terre de roches. La couche arable des Laurentides est mince, les familles étaient nombreuses. On parle d’une agriculture d’autosuffisance. Les hommes n’avaient pas vraiment le choix.»
«Pendant ce temps, les femmes, qui se comptaient par milliers elles aussi, prenaient la relève. Si je voulais poursuivre sur un autre thème en lien avec les chantiers, ce serait sur leurs épouses qui restaient l’hiver à la maison que mon choix se porterait. Elles répondaient aux besoins des jeunes enfants, assumaient les travaux de la ferme et tenaient maison, seules, pendant de longs mois d’hiver. Sur qui pouvaient-elles compter? Avec qui pouvaient-elles parler?»