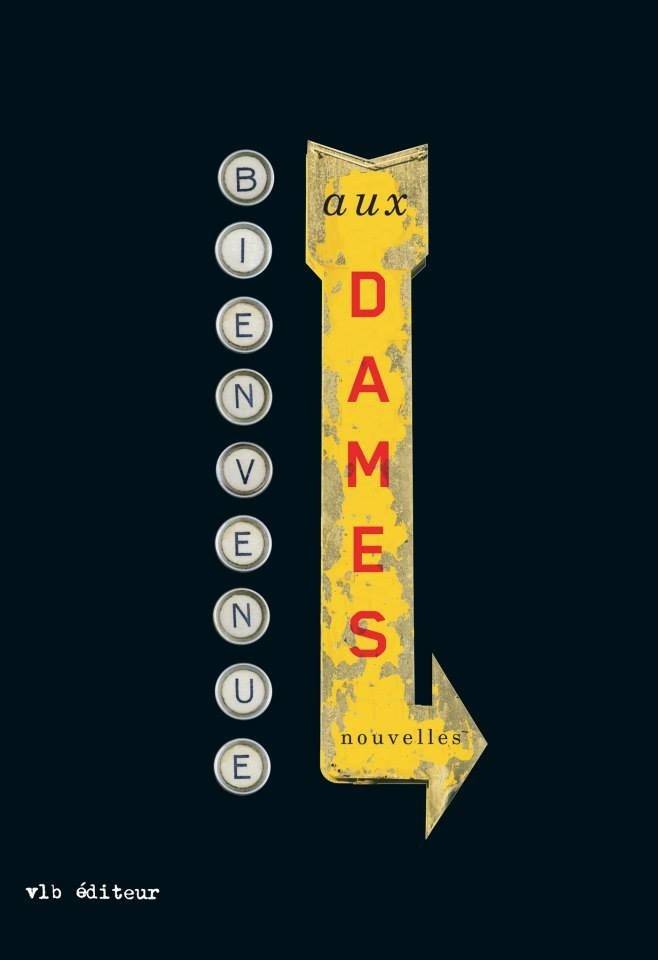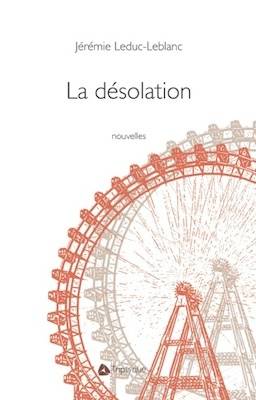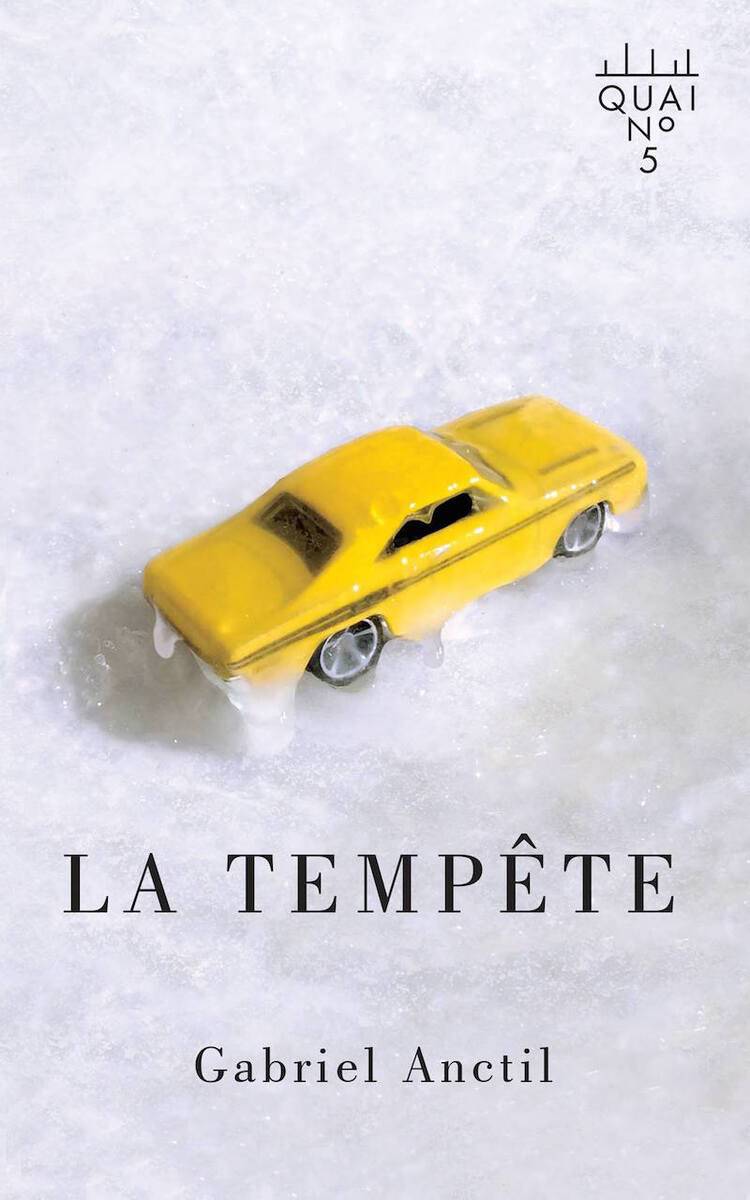LittératureRomans québécois
Crédit photo : Éditions du Boréal/ Catherine Gravel
À travers ce roman de 432 pages, on entre tout de go dans l’Histoire, en 1642, alors que de Paul de Chomedey pose les pieds sur une île qui deviendra très importante en Nouvelle-France. Mais le protagoniste réel de ce récit est en fait Jeanne Mance qui découvre, comme les autres qui sont partis de l’Europe pour l’Amérique, une nouvelle vie. S’adapter à une vie qui change, c’est aussi le lot de Gaby, Thomas, Laurel, Markus, Laila et les autres Montréalais du XXIe siècle. Pour certains, c’est le deuil d’un proche, pour d’autres, le changement de cap est le rejet du conditionnement familial et du carcan religieux.
Plusieurs histoires différentes tapissent le livre de Proulx publié aux Éditions du Boréal. Gaby, enseignante dans une classe d’immersion française, ainsi que son frère Thomas, doivent composer avec la mort de leur mère Françoise. Pour Laurel, fils de Thomas, c’est la grand-mère surnommée Framboise qui occupe ses pensées ainsi que cette idée romanesque autour de Jeanne Mance… Pendant ce temps, la vie continue, c’est-à-dire que les remises en question au sujet du travail, de l’amour et de l’identité ne cessent pas. On rencontre aussi d’autres humains comme Zahir Ramish, ce musulman recherché notamment par la GRC, qui se réfugie dans l’église du Père Guillaume.
Dans la rue, il y a aussi une vie, même si on la préfère invisible socialement et individuellement. Charlie Putulik, itinérant, et Tobi Crow, un Mohawk alcoolique et aveugle, toujours avec son chien, en témoignent. Celui-ci a d’ailleurs inspiré le personnage de Tobias Crow dans Invisible Man, une série télé scénarisée par Thomas.
Il faut relever qu’avec cette faune bien diverse, l’auteure nous convie dans une métropole bien réelle, même s’il s’agit d’une fiction. Les itinérants, les Autochtones, les communautés culturelles sont bien représentés, sans jugement ni complaisance. Chaque personnage est incarné et l’on sent que l’écrivaine habite chacun d’eux et a travaillé leur complexité intérieure de manière à les faire ressortir comme des êtres authentiques, que l’on pourrait croiser dans les rues de la métropole québécoise.
À cet égard, rien n’est plus jouissif que de suivre les pérégrinations de ces êtres imparfaits et l’on se plait à observer l’éclosion de Markus Kohen, ce juif hassidique qui ne rêve que de liberté moderne. «Il vient d’avoir vingt ans. Il sait où il va. Il va vers l’est, vers les hommes qui mangent du cochon avec de la crème et les femmes qui montrent leur poitrine, mais aussi vers l’est de Hashem et Yerushalayim, car ce n’est pas vrai que tout est séparé, ça ne peut pas être aussi étriqué que ça, Dieu, ça ne peut pas palpiter uniquement dans la piété et le renoncement, à une telle distance de lui-même. Il va vers lui-même.»
En parallèle, les péripéties de Jeanne Mance ramènent le lecteur à une époque de changement de paradigme en Amérique. On retient bien sûr le climat qui ne rappelle pas celui de la France, mère patrie, l’importance de la religion dans l’édification de cette nouvelle société et les Amérindiens qui verront l’arrivée des colons d’Europe. On traverse autant les intempéries de la nature que celles des humains, notamment les conflits meurtriers entre Iroquois et Algonquins, dans lesquels les «Montréalistes» essaient de se tailler une place afin d’abord de survivre. La difficile cohabitation entre les Premières Nations d’Amérique et les hommes et femmes qui prendront possession du territoire perdure encore aujourd’hui, faut-il le souligner.
L’écrivaine dessine des personnages que l’on imagine aisément marqués par la vie, comme dans tout ce qu’elle livre, les éloigne de la caricature, et les portraiture avec une grande finesse. Petit bémol: le chapitre «Le rendez-vous», intéressant d’un point de vue littéraire, puisqu’il s’agit d’un jet d’écriture d’un des personnages principaux du roman (Laurel), semble s’éterniser, même si le rythme est bien cadencé. Il aurait été plutôt judicieux de resserrer cette partie.
Au final, le lecteur goûte au travail de Monique Proulx – la dernière fois était lors du magnifique Champagne en 2008 – qui signe ici un roman écrit avec un style qui lui est propre: des dialogues animés, une limpidité digne des grands romanciers, une richesse dans le choix des mots ainsi que l’originalité de la narration. Elle confirme ici sa place au podium des grands écrivains de la littérature québécoise tout comme celle de peintre de Montréal.
Ce qu’il reste de moi, Monique Proulx, Éditions du Boréal, 432 pages, 2015, 29,95 $.
L'avis
de la rédaction