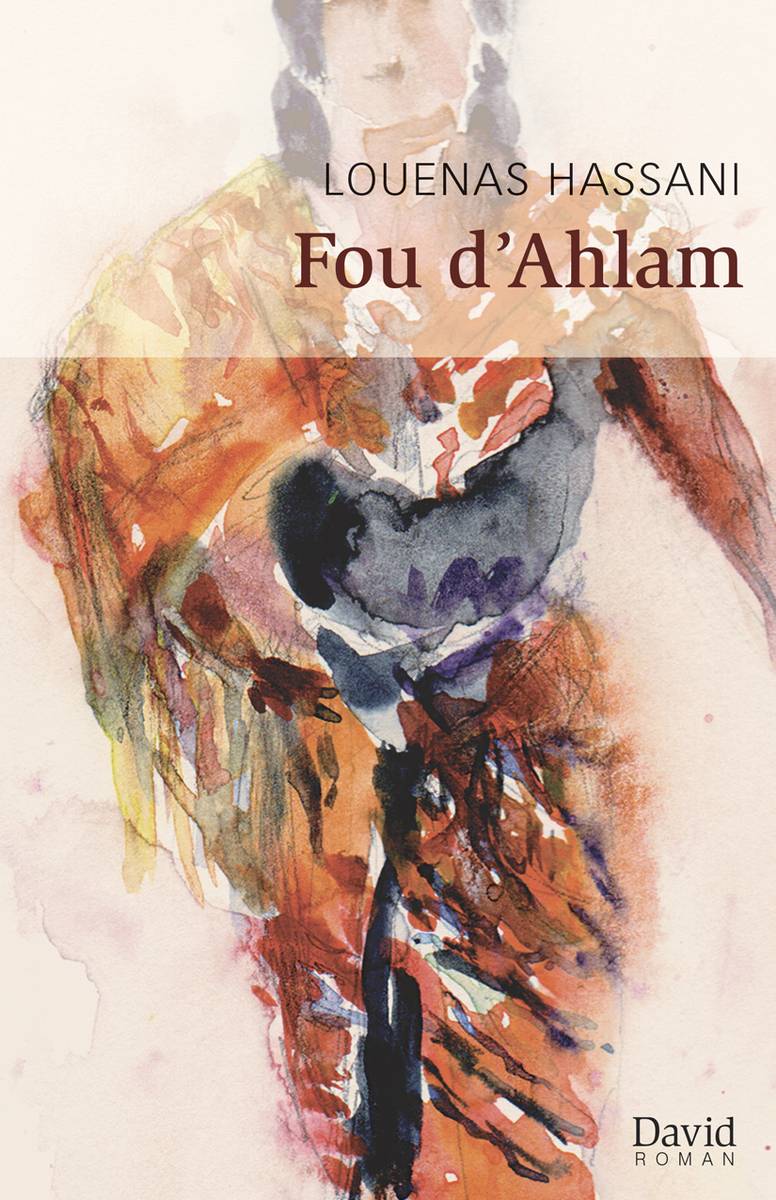LittératureL'entrevue éclair avec
Crédit photo : Nana Photography
Louenas, c’est un plaisir de faire votre connaissance! Vous qui êtes né à Bejaia, en Kabylie maritime, vous avez quitté l’Algérie en 2001 afin de poursuivre vos études à Paris, tout juste avant d’immigrer au Québec en 2006. Dites-nous comment ces nouveaux départs et ces changements de culture ont façonné la personne que vous êtes devenue aujourd’hui.
«D’abord, merci pour votre sollicitation. Pour en venir directement à la question, c’est Carlo Goldoni, le fondateur du théâtre italien moderne, qui disait que celui “qui n’a jamais quitté son pays est plein de préjugés”. Bien entendu, les mots ne sont pas à prendre au pied de la lettre, tant la raison et le bon sens suffisent souvent pour aller outre la tribu en nous, mais le voyage, les livres, les rencontres forgent notre identité en édifiant des ponts nouveaux. L’identité n’est pas que la référence, l’héritage symbolique si l’on veut, mais elle est aussi en perpétuel devenir. C’est Héraclite qui disait que l’on ne se baignait pas deux fois dans le même fleuve…»
«Je crois que dans mon cas, être berbère, «Amazigh» dans ma langue maternelle, littéralement un homme libre qui ne croit pas aux frontières que celles que dicte le cœur, abrège la géographie. “Ma race, la race humaine; ma religion, la fraternité”, disait Aimé Césaire.»
C’est en 2016 et 2017 que vous avez fait votre entrée sur la scène littéraire franco-canadienne avec deux romans que vous avez publiés aux Éditions de L’Interligne, soit La coureuse des vents et La république de l’abîme. En plus de votre carrière d’écrivain, vous enseignez dans une école francophone d’Ottawa. Quand est née votre passion pour la langue française, et à quel moment avez-vous eu cet appel pour le partage du savoir, la littérature et bien sûr l’écriture?
«Écrire est un rêve d’enfant que j’ai d’abord fait dans ma langue maternelle, le tamazight, celle qui transporte le parfum du lieu originel; puis, dans ma langue seconde, la langue arabe, même si elle nous a fait violence; c’est grâce à elle que j’ai découvert les trésors de la littérature arabe, une poésie qui n’a pas son égale pour féconder le silence et l’infini; enfin, la langue de Molière, que j’ai d’abord aimée grâce à la plume d’écrivains algériens. J’ai adoré la manière dont Kateb Yacine, Mouloud Mammeri, Mouloud Feraoun, Taous et Jean Amrouche, Nabil Farès, Malek Ouary, Mohamed Dib, Rachid Boudjedra, par exemple, faisaient dire cette magnifique langue en lui injectant notre soleil, nos colères, les intimités de la langue mère, lui faisant subir notre capital symbolique; une littérature qui transpire l’indignation de l’indomptable Kahina (Dyhia), l’une des premières reines historiques, doublée d’une poétesse pour galvaniser les foules contre les hordes conquérantes d’Okba; Jugurtha sur son cheval sans selle, allant plus vite que le vent, défiant l’insubmersible Rome; bref, de rêve insoucieux au besoin de dire la singularité, la colère contre l’injuste.»
«Mes deux premiers romans sont «des coups de hache dans la mer gelée en nous», quand dire est une nécessité élémentaire. La coureuse des vents est pour abolir les identités meurtrières; La république de l’abîme hurle le danger mortifère de la certitude, de l’islam politique notamment, une idéologie «rationnelle» de l’aliénation des masses.»
Le 16 août, les Éditions David ont levé le voile sur votre troisième roman, Fou d’Ahlam, à travers lequel on fait la connaissance d’Elian, un jeune professeur de philosophie qui va tomber sous le charme d’une ravissante étudiante en médecine, nommée Ahlam («rêves» en arabe). Malheureusement, la répression politique en Algérie, couplée à l’urgence sanitaire, va mettre un frein à leur premier rendez-vous… D’où vous est venue l’inspiration pour cette histoire qui donne vite envie de s’y plonger?
«Fou d’Ahlam s’intitulait au départ L’amour à l’heure du coronavirus et de la colère… ou de la répression. Je voulais écrire quelque chose d’allégorique sur la pandémie, mais un ami m’a suggéré d’écrire pour les adultes et sur la pandémie. Le lendemain, j’ai écrit une vingtaine de pages. C’est un roman dont j’ai écrit le premier jet en en trois ou quatre mois. J’avais le terreau fertile où puiser. Il fallait juste lire, contacter des ami.e.s professionnel.le.s de la santé pour vivre plus affectivement le drame que cause le coronavirus, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite… Replonger dans certains livres comme La peste de Camus, 1984 d’Orwell… L’espace-temps de la trame est trouvé.»
«En somme, l’histoire est née d’elle-même, et ce, même si pour moi un roman est généralement une aventure dont je ne prédis pas l’issue. Les personnages: un philosophe, Élian, et l’allégorie du marteau qui brise les idoles, et une femme médecin, Ahlam ou «rêves» en arabe, pour redéfinir notre rapport au corps, peindre le Je de la subversion au milieu du Nous castrateur qui empêche l’individu, et surtout à l’épicentre d’une presque-révolution, d’une dictature qui réprime et d’un islamisme de plus en plus violent.»
«Fou d’Ahlam devient le rêve de liberté, d’une femme, d’une Algérie enfin libre et démocratique.»
À travers cette histoire contemporaine d’une romance naissante qui se voit aussitôt brimer par un contexte sociopolitique oppressant, vous décrivez «avec sensibilité le rêve et la marche de la jeunesse algérienne [qui souhaite] se sortir de la dictature», en plus d’aborder «la condition des femmes dans une société ultraconservatrice [ainsi que] la place de l’austérité au milieu de l’urgence sanitaire […]». D’après vous, est-ce que l’amour triomphe toujours des épreuves de la vie?
«Ce n’est pas «l’évènement» qui change les hommes, mais les petites choses quotidiennes de la vie: la subversion par la durée qui installe le baiser dans la «normalité», la main dans la main d’un couple sur une place publique, la différence qui n’attente aucunement aux dieux célestes ou terrestres…»
«L’amour dans l’histoire est transgression de l’uniforme: religion, ordre, bien-pensance, le Nous simplement. Il est une allégorie pour dire que, pour changer la société, il faut d’abord changer les individus. Et avant, il faut fouailler l’impensé, agiter “la mer gelée” en nous, déconstruire les mémoires mortifères pour s’ouvrir sur le possible. La femme offrant sa virginité un jour de ramadan, la pandémie redéfinissant le rapport à la mort, à l’Autre, mais aussi à l’univers, c’est pour rappeler l’évidence que l’homme n’est pas un être à part…»
«Alors, oui, l’amour est une oasis de possibles qui peut venir à bout d’un désert d’interdits, un pied de nez au moins contre les idéologues de la tyrannie et l’islamisme. Il ne suffit pas de déverser une révolution dans un boulevard pour changer le monde.»
Et si l’on vous demandait quel pourrait être le sujet de votre prochain roman, seriez-vous capable de nous répondre du tac au tac? On est juste un peu curieux, c’est tout!
«Il est déjà chez l’éditeur! C’est une belle édition algérienne intitulée Nous sommes tous des étoiles filantes, un roman qui voyage entre l’enfance, une peinture où l’art magnifie le vivant, une grand-mère pour une mémoire qui redéfinit le rôle des étoiles filantes, pour in fine une abolition de la géographie intérieure comme celle qui érige les murailles en nous.»
«J’espère bien sûr le publier ici, au Canada, après son apparition dans mon pays d’origine.»