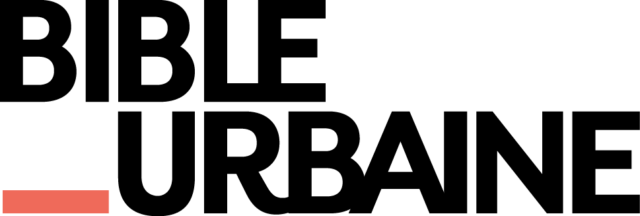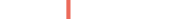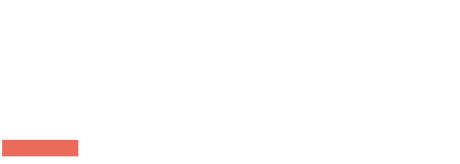LittératureDans la peau de
Crédit photo : Tous droits réservés @ Les éditions du Septentrion
Marc, c’est un plaisir de vous accueillir à cette série d’entrevues! Vous êtes originaire du Nouveau-Brunswick et l’une de vos passions dans la vie, c’est le journalisme, un métier que vous exercez depuis un bon nombre d’années. De plus, vous siégez également au conseil d’administration de la Société historique acadienne. Dites-nous, à quel moment de votre cheminement professionnel le journalisme s’est-il imposé comme un choix évident? On serait aussi curieux de savoir en quoi vos implications comblent l’homme assoiffé de connaissances que vous êtes!
«Dans les années 1980, je vivais à Fredericton. J’avais à peine vingt ans et j’étais un genre d’agent de communication pour le centre scolaire communautaire francophone de l’endroit. Cela m’a amené à avoir des contacts avec le journal l’Acadie Nouvelle, qui venait d’ouvrir. J’ai commencé à faire de la pige pour ce dernier et, de fil en aiguille, je me suis retrouvé journaliste à temps plein. J’ai su dès le départ que c’est ce que je voulais faire dans la vie.»
«Après mes cinq ans à l’Acadie Nouvelle et une autre vingtaine d’années à Radio-Canada par la suite, j’ai eu l’envie d’aller plus en profondeur dans mes sujets. C’est ce qui m’a amené à l’écriture de chroniques, puis de livres.»
«Cet autre mode d’écriture me permet d’explorer toutes sortes de sujets et d’en savoir plus sur notre monde.»
Depuis 2020, vous signez des chroniques sur l’histoire de l’Acadie dans l’Acadie Nouvelle, un quotidien francophone et indépendant disponible sous la forme d’un journal papier et d’un site médiatique Web. Et à la radio de Radio-Canada, vous présentez une chronique sur l’histoire des familles acadiennes. Par le passé, on posait déjà la question à Annette Léger-White, Éric Thierry, Hugues Théorêt ou encore Gregory M. W. Kennedy: d’où vient cet intérêt particulier pour la culture acadienne?
«Évidemment, l’intérêt de quelqu’un pour sa propre culture est tout à fait naturel, surtout quand on baigne dedans. J’ai eu la chance de grandir à Caraquet, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, un endroit qui vit en français presque à 100% et où l’identité et la culture acadienne sont très fortes.»
«En pratiquant le journalisme, j’ai pu mieux comprendre la société dans laquelle on vit. J’ai développé le goût de raconter l’historique des démarches, des institutions et des personnages du moment. J’ai alors réalisé comment l’histoire de l’Acadie est peu enseignée à l’école, et c’est encore vrai aujourd’hui.»
«Et ce n’est pas tout le monde qui va lire de gros livres d’histoire! Mais beaucoup de gens lisent les journaux, et plusieurs sont intéressés par leur histoire. En écrivant des articles et maintenant des chroniques historiques, c’est un moyen, pour moi, de propager cette histoire dans un format plus accessible, à une époque où la capacité d’attention est en diminution.»
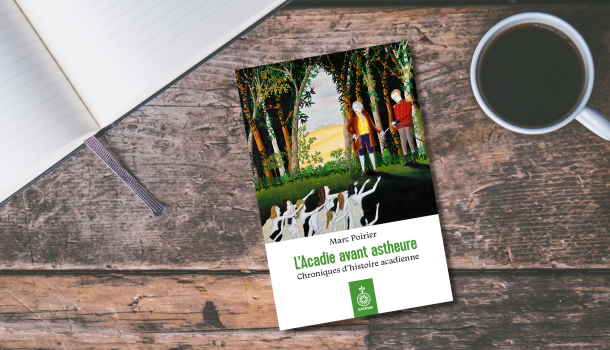
Fort de plus d’une centaine de chroniques rédigées pour le journal l’Acadie Nouvelle, vous avez décidé d’en sélectionner quarante d’entre elles, afin de les réunir au cœur d’un ouvrage, L’Acadie avant astheure: Chronique d’une histoire acadienne, une nouveauté au rayon des éditions du Septentrion. Dans ce livre illustré de 234 pages, vous abordez divers thèmes, ainsi que des fragments d’histoire, pour permettre à vos lecteurs et lectrices «d’en savoir plus sur les origines et le destin du peuple acadien». Qu’est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l’écriture d’un ouvrage de longue haleine? Offrez-nous un tour d’horizon des thèmes abordés, on est curieux d’en savoir plus!
«C’est un peu particulier, car bien des années après avoir été journaliste pour l’Acadie Nouvelle d’abord, puis pour Radio-Canada Acadie par la suite, j’ai effectué un retour à ces deux médias comme chroniqueur. L’occasion s’est d’abord présentée à l’Acadie Nouvelle quand, à l’hiver 2020, un chroniqueur a cessé d’écrire pour le journal. Ayant l’idée depuis un moment d’écrire des chroniques historiques, je me suis proposé et ce fut un départ!»
«Deux ans plus tard, Francopresse, un média numérique pour lequel j’écrivais à la pige, m’a proposé une chronique qui s’intitule Dans le rétroviseur, et qui jette un regard en arrière sur des événements, des personnalités, des objets en tous genres.»
«Enfin, l’an dernier, Radio-Canada Acadie (basée à Moncton), m’a proposé une chronique à la radio afin que je puisse décortiquer l’histoire des familles acadiennes. C’est pour moi un grand bonheur de refaire de la radio, un média que j’adore.»
Tout le monde est sensibilisé au drame que fut la Déportation des Acadiens par les Britanniques, entre 1755 et 1763, mais peu de gens savent ce que deviennent les Acadiens, 400 ans après la fondation de l’Acadie. Et pourtant, des gens habitent ce territoire et y parlent la langue de chez nous! Dites-nous-en plus à ce sujet et, d’après vous, ceux et celles qui liront votre livre, qu’apprendront-ils sur l’histoire de l’Acadie?
«Étant une petite population comparée à celle du Québec, l’histoire ancienne et récente de l’Acadie est parfois encore méconnue, même si nous sommes le voisin d’à côté. Les Québécois et Québécoises en savent un peu plus sur la réalité de la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick, mais plusieurs sont encore surpris d’apprendre comment la langue française et la culture acadienne sont bien vivantes à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, de même qu’à Terre-Neuve-et-Labrador.»
«Ils ont en effet leur réseau d’écoles françaises, leurs institutions et même une université francophone à Pointe-de-l’Église, en Nouvelle-Écosse. Mes chroniques, je l’espère, permettent d’en apprendre sur la situation très particulière que vivaient les Acadiens, alors que leur territoire passait constamment de la France à l’Angleterre, ayant à vivre avec le dilemme constant de devoir rester ou partir, en plus de la menace persistante de déportation, qui a plané jusqu’en 1755.»
«Au sein de cet ouvrage, on y découvrira aussi les péripéties incroyables de ces milliers d’Acadiens dispersés des deux côtés de l’Atlantique est des innombrables déplacements, volontaires ou forcés, qu’ils ont effectués avant de s’enraciner à nouveau ici et de créer de nouvelles Acadies ailleurs.»
Maintenant que vous avez écrit un ouvrage archicomplet sur l’histoire acadienne, est-ce qu’il y a un autre pan de l’histoire qui continue d’attiser votre curiosité, encore aujourd’hui?
«Je continue toujours d’écrire des chroniques pour le journal l’Acadie Nouvelle et je m’attarde de plus en plus sur la période un peu plus récente, soit la fin du XIXe siècle et le début du XXe. C’est une époque qu’on a appelé la “Renaissance acadienne”, lors de laquelle le peuple acadien a commencé à se doter de symboles, de structures, de “faire société”, comme le dit souvent le sociologue acadien Joseph-Yvon Thériault, ancien professeur à l’UQAM.»
«C’est dans cette période que diverses congrégations religieuses se sont implantées et ont fait pousser des écoles, des hôpitaux et les premiers collèges classiques francophones d’où a émané la première élite acadienne. C’est aussi à ce moment que les premiers journaux acadiens ont vu le jour.»
«Tout cela a contribué à forger l’identité acadienne et à jeter les bases de cette société de langue française très distincte que l’on connaît aujourd’hui et que l’on appelle toujours l’Acadie.»