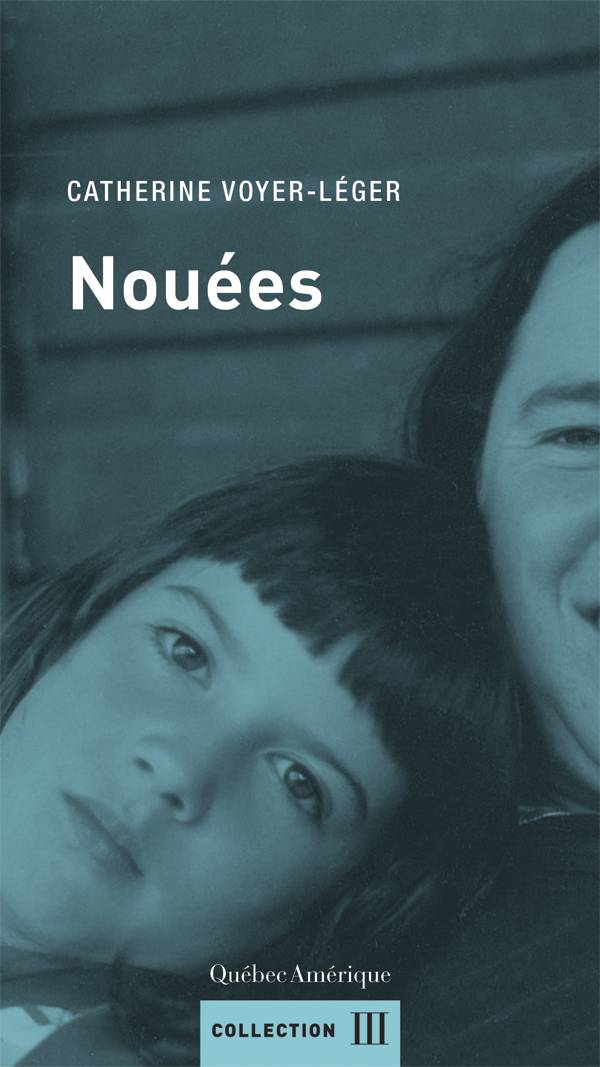LittératureLa petite anecdote de
Crédit photo : Martine Doyon
La fin de l’année
J’ai toujours détesté les fins d’année scolaire. Toute jeune, à l’école primaire, tandis que tous les enfants autour de moi s’élançaient vers la sortie en lançant leurs sacs au bout de leurs bras, moi je me traînais les pieds dans les couloirs bientôt vides et j’attendais patiemment d’être loin de mes pairs pour pouvoir brailler la face cachée dans mon oreiller.
J’étais une enfant assez solitaire et l’école avait le grand avantage de m’occuper, de me faire voir du monde, même si j’avais le sentiment d’y trouver plus d’ennemis que d’amis. Mais ma peine était surtout liée à cette impression du temps qui passe, de l’éphémère, de tout ce qui nous échappe. Et j’avais raison d’avoir peur…
Qu’est-ce que je garde aujourd’hui de mes premières années d’école? La vérité c’est qu’on oublie presque tout. J’en avais l’intuition et ça me mortifiait.
En quatrième année, j’étais dans la classe d’Annette – à cette époque nous appelions les enseignantes par leur prénom seulement! –, une femme assez âgée qui répétait constamment qu’elle n’avait pas de chouchou, mais envoyait toujours les deux mêmes petites filles très propres lui remplir son verre d’eau. Je n’ai plus un souvenir précis du contexte, mais je suppose que nous avions dû organiser une petite fête de fin d’année, du type démonstration de talents. Je revois le décor: tous les pupitres vidés et lavés, rangés contre les murs, les chaises formant un grand cercle au centre de la classe.
Et moi qui ai quelque chose à dire.
C’était déjà ça mon «talent»: dire. Écrire. Communiquer, quoi! Faire brailler le monde aussi. (Nous étions évalués à cette époque sur des oraux expressifs et je faisais toujours brailler le prof. J’avais toujours une excellente note).
Alors, j’avais décidé que pour ce petit événement de fin d’année, j’allais prendre la parole. Me vider le cœur. Dire enfin la vérité. J’allais dire que moi, je n’aime pas ça la fin d’année et que je me cache chaque fois pour aller pleurer. Je me suis donc levée et j’ai fait mon petit discours. Je l’avais écrit. Je l’avais appris.
C’était aussi une sorte d’hommage à mes collègues de classe, une façon de leur dire que j’aurais bien voulu que ça ne s’achève pas… même si, objectivement, ça n’avait pas été une super année sur le plan social!
Mon discours a été suivi d’un silence médusé. Les classes d’école primaire des années 1980 n’avaient pas grand-chose à voir avec les ateliers d’écriture du XXIe siècle: on ne s’attendait pas vraiment à ce que vous vous y montriez vulnérable. Même les petits caïds de la cour d’école ne savaient pas quoi répondre à ça.
C’est Mathieu qui a parlé. Je m’en rappelle, parce que depuis la première année, j’étais un peu amoureuse de lui. Il a dit: «Ben, je pense qu’on se sent tous un peu comme ça même si on le dit pas».
(Avouez que, vous aussi, vous auriez été un peu amoureuse de lui…)
Chaque fois qu’en entrevue on me parle de l’impudeur de mes écrits, du courage que ça prend pour écrire des livres autobiographiques, des risques que ça fait courir de s’ouvrir en public, je repense à cette scène.
J’avais 10 ans. Nous étions le 21 ou le 22 juin 1990 dans la classe d’Annette à l’école primaire Saint-Édouard à Saint-Sauveur-des-Monts. J’avais 10 ans et je ne m’étais jamais sentie aussi solide de ma vie, aussi confiante en l’avenir.
Ce jour-là, j’ai compris trois choses.
Un. La vulnérabilité assumée est un bouclier.
Deux. On n’est jamais seul à vivre ce qu’on vit.
Trois. Savoir communiquer allait me sauver la vie.