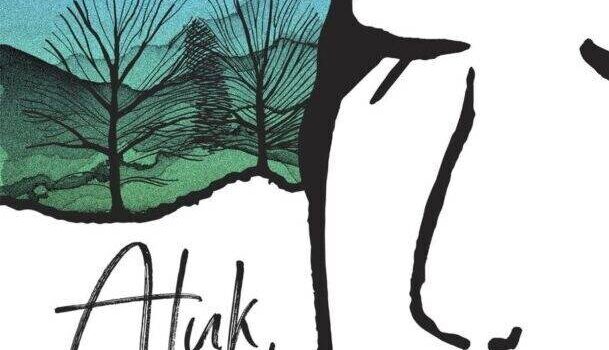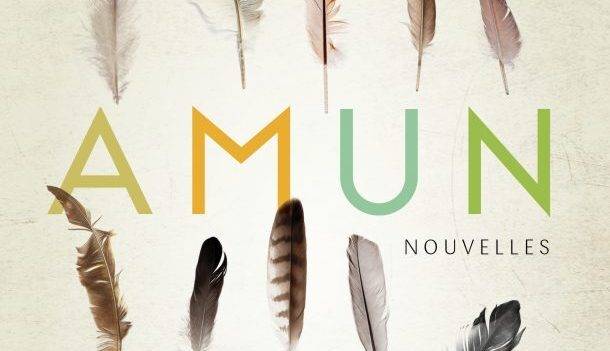LittératureRomans québécois
Crédit photo : Libre Expression
Atuk, c’est le nom innu de la famille de Michel Jean, les Siméon. Nous découvrons leur histoire par le biais de la voix de Jeannette, la grand-mère de l’auteur, et de celle de ce dernier. Ces narrations, à force de s’entrecroiser, tressent peu à peu le portrait d’un monde qui n’a pas disparu sans laisser de traces: au contraire, ses échos se répercutent toujours, de génération en génération.
«Encore aujourd’hui, quand je vais à Sorel pour visiter ma mère, il m’arrive de me rendre à l’endroit où se dressait autrefois le vieux fort. Debout au milieu du parc de stationnement, j’imagine les Mohawks émergeant du sud à bord de leurs canots d’écorce. Des hommes vigoureux et sans peur, ramant en cadence. Je les vois passer devant moi, puis à l’embouchure du fleuve, virer à gauche pour remonter le courant en direction de Ville-Marie. Je ressens alors un mélange de crainte et de fierté.»
Atuk, elle et nous est un roman construit de toutes pièces autour de la question de l’identité. Pour Michel Jean, écrire son peuple et sa famille est une manière de déterrer sa propre histoire, de s’identifier à cette communauté au sein de laquelle il n’a pu grandir et dont il n’a pas appris la langue, une des cicatrices qui l’a aidé à revendiquer son autochtonie.
Aujourd’hui, le mot innu figure sur le quatrième de couverture de ses livres: une fierté qu’il tente de transmettre aux jeunes autochtones en leur faisant savoir qu’eux aussi ont le droit d’écrire des livres. Ce chemin long et sinueux vers ses racines est justement l’objet de son récit: une démarche qui prend encore plus de sens lorsqu’on sait que c’est à partir des funérailles de sa grand-mère que Michel Jean embrasse son héritage culturel. L’auteur nous raconte l’ignorance de son enfance, celle des cours d’histoire du système scolaire, et les erreurs qui ont parsemé ses tentatives de dresser des ponts entre les fragments de son identité.
Le personnage de Jeannette est lui aussi aux prises avec des problèmes du même ordre qui se manifesteront à travers ses contacts avec les blancs. L’école d’abord, une précaution prise par sa mère, qui vient altérer l’identité de fille de la forêt si chère à la jeune innue. Lorsqu’elle rencontre Thomas, un ouvrier au sang mélangé, mais dont le statut est celui d’un blanc, Jeannette doit faire un choix impossible entre l’amour et sa patrie. Un choix qui aura un impact direct sur le destin de sa descendance, sur celui de son petit-fils Michel.
«Même si le calme de ma grand-mère me rassurait, je restais malgré tout un peu inquiet. Un médicament, une pilule, un sirop, une piqûre même, je savais que ça pouvait guérir. J’en avais souvent eu. C’était en plus prescrit par des médecins. Des gens qui avaient étudié à l’université. Des gens instruits. Mon jeune esprit formé à l’école comprenait cela. Mais un bout de racine caché dans une corde de bois par ma grand-mère, qui n’était certainement pas allée à l’école très longtemps, et bouilli dans de l’eau du robinet? Cela n’avait rien de scientifique, donc rien de rassurant.»
Michel Jean fait partie de ces écrivains qui ont la capacité de raconter plusieurs fois une même histoire sans pour autant se répéter. En effet, son roman Kukum, publié en 2019 et lauréat du Prix littéraire France-Québec 2020, complète le récit présenté dans Atuk, elle et nous. Cette fois, c’est la voix d’Almanda, l’arrière-grand-mère de l’auteur, que nous écoutons. L’histoire de cette femme d’origine irlandaise, devenue innue en épousant Thomas Siméon, est le miroir de celle de Jeannette.
Cependant, les deux œuvres sont bien distinctes l’une de l’autre. En effet, Kukum nous fait découvrir toute la brutalité de la sédentarisation des autochtones, depuis la destruction soudaine de leurs territoires de chasse jusqu’aux pensionnats. Atuk, elle et nous s’attarde moins sur ces points, mais traite de racisme avec une perspective actuelle apportée par la voix de l’écrivain.
Cette violence, Michel Jean nous la décrit avec sobriété. Il affirme vouloir écrire simplement, et le réalisme minimaliste de sa plume en fait sa force: la réalité des autochtones n’a pas besoin d’être amplifiée pour nous émouvoir et nous choquer. Chez cet auteur, chaque mot a sa place, son rôle, son impact. Cela n’a pas empêché la présence de certaines répétitions dans les propos des narrateurs, qui donnent une impression de longueurs dans un texte pourtant court.
Malgré cela, l’auteur réussit habilement à créer une ambiance qui enveloppe les lecteurs, un cocon de douceur dans lequel il nous place pour mieux suivre les déplacements périlleux de ses ancêtres nomades. Le calme inébranlable que l’on sent se répandre au fil des pages, c’est l’innu en Michel Jean, dont une cousine éloignée lui parle au début du récit.
Dans un lycée de France, une professeure fait lire Kukum à ses élèves. Un choix judicieux, car Kukum et Atuk, elle et nous sont des lectures tout indiquées pour le secondaire, leur ton convenant autant à cette tranche d’âge qu’aux adultes. Ils représentent l’un autant que l’autre une belle porte d’entrée dans l’univers de Nitassinan, que l’on a, jusqu’à présent, toujours négligé dans les programmes d’histoire.
Le Québec aurait tout avantage à mettre davantage les livres de Michel Jean à l’honneur.
L'avis
de la rédaction