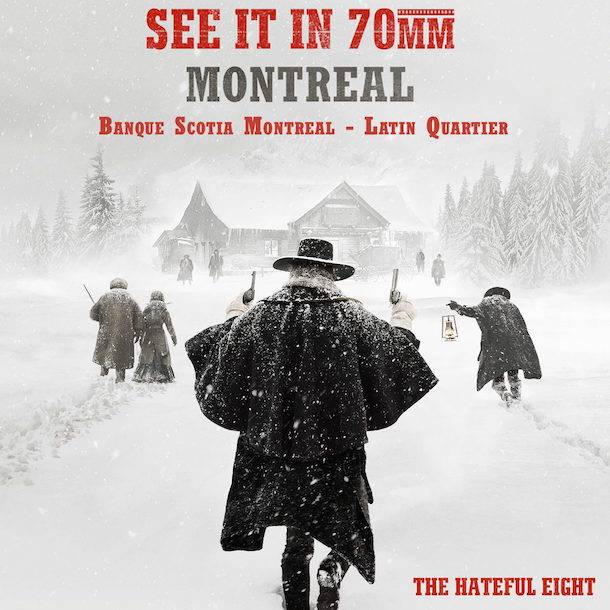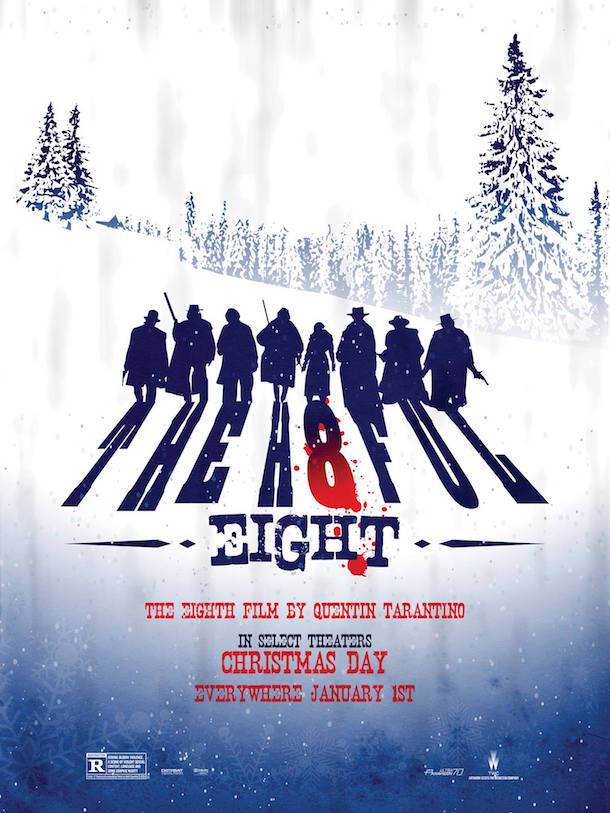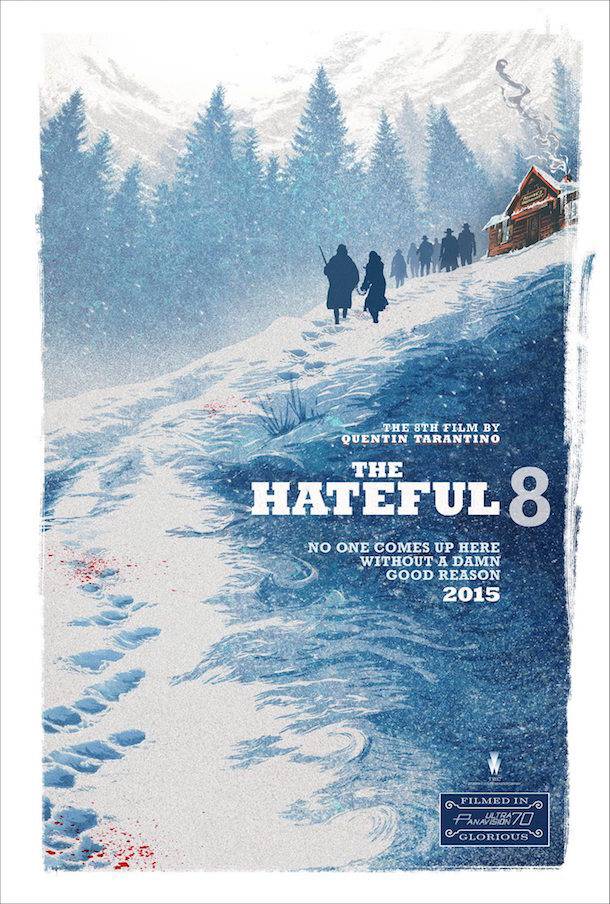CinémaCritiques de films
Crédit photo : The Weinstein Company
Affichant un aplomb digne de son auteur, presque présomptueux, le deuxième western de Quentin Tarantino commence à la manière des productions épiques d’antan, les grandioses Ben-Hur, Lawrence of Arabia, Doctor Zhivago et autres Gone with the Wind pour n’en nommer que quelques-uns, c’est-à-dire en présentant une «ouverture».
Ainsi, la pièce orchestrale de 7 minutes et des poussières, «L’Ultima Diligenza di Red Rock» écrite par le légendaire Ennio Morricone, sera entendue dans son entièreté sur un fond visuel fixe. Une illustration toute de rouge et de noir, lugubre et porteuse de mauvais augure, représentant une diligence se dirigeant vers une destination que l’on devine peu recommandable. Le ton est donné. Cette ouverture permet, d’une part, d’apprécier pleinement le travail de l’illustre compositeur italien, et, d’autre part, de se mettre en appétit pour la suite!
La diligence en question contient pour passagers John Ruth (Kurt Russell), un chasseur de primes, ainsi que sa captive Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh), punching bag humain et criminelle détestable, dont la tête a pour valeur la rondelette somme de 10 000 $. Reconnu pour ses principes, Ruth s’engage à livrer vivante sa prisonnière à la justice afin qu’elle y subisse la mort par pendaison.
Chevauchant vers la ville de Red Rock, le cortège croise le chemin de Marquis Warren (Samuel L. Jackson, dans un rôle taillé sur mesure), lui aussi chasseur de primes et détenteur d’une précieuse lettre signée par nul autre que le président Lincoln, objet quasi religieux.
Chris Mannix (Walton Goggins), un renégat sudiste et supposé nouveau shérif de Red Rock (sans toutefois pouvoir le prouver), se joindra au groupe alors qu’un blizzard, au loin, gagne en intensité.
Face à cet affront de la nature, il est décidé d’un commun accord de faire escale dans une mercerie montagneuse. Mais à la surprise générale, la patronne de l’établissement n’est plus là… À sa place se trouvent quatre étrangers. Bob (Demian Bichir), Oswaldo (Tim Roth), Joe (Michael Madsen) et, finalement, un général confédéré répondant au nom de Smithers (Bruce Dern). Tout de suite, la méfiance s’installe. Se pourrait-il que la venue de Daisy en ces lieux ne soit un secret pour personne?
Huit personnages ayant chacun des raisons d’en détester un autre. Huit personnages ne disant pas toute la vérité sur qui ils sont et la nature de leurs intentions. De ce nombre, beaucoup périront.
Situées environ 10 ans après la guerre de Sécession, les tensions raciales et les vieilles rancunes entre camps opposés meuvent la première partie du récit. Marquis Warren, le seul noir du groupe, semble donc de prime abord la cible désignée pour se faire descendre le premier.
Contrairement à Django Unchained, où une trop grande partie du plaisir provenait du charisme intarissable de Christoph Waltz (désolé, Jamie Foxx), ici c’est une myriade de personnages mémorables qui se partagent la réplique. La distribution a quelque chose à y voir. En effet, il s’agit probablement de l’ensemble le plus tarantinesque depuis Pulp Fiction. Ne manquerait plus qu’un caméo d’Uma Thurman pour que la Sainte Famille affiche pratiquement complet!
Du lot, Samuel L. Jackson et Kurt Russell se partagent la part du lion. Hilarant, Jackson livrera même un monologue n’étant pas sans rappeler la joie fébrile d’un «Ézéchiel 25, verset 10», passage biblique le plus connu des athées cinéphiles. Walton Goggins, dans le rôle d’un shérif capable autant de bêtise que de génie, gagnera sans cesse en complexité et deviendra, à sa manière, aussi marquant que les deux têtes d’affiche.
Les films de Quentin Tarantino ont toujours eu par définition une nature extrêmement verbeuse et The Hateful Eight ne déroge certainement pas à cette particularité. Ça jase beaucoup dans la diligence et la mercerie; de fait, les préliminaires avant que les pions ne se mettent en marche ont tendance à s’étirer.
Des dialogues qui ne font pas toujours avancer l’histoire ou développer la personnalité d’un personnage, il y en a toujours eu dans la filmographie de Tarantino. C’est peut-être que cette fois-ci, les échanges affichent un aspect moins punché, offrant un nombre réduit de matériels à citations. Rien de trop fâcheux, mais juste assez pour se poser la question «Est-ce tout?». Une question qui semblera totalement dérisoire une fois le deuxième acte mis en branle.
Mais avant, une pause pipi. Parce que oui, The Hateful Eight, en plus d’une ouverture classique, se permet également un entracte de 15 minutes. Je ne sais pas pour vous, mais j’applaudis cette décision. Nos aïeux avaient compris, eux, que les séances assises de plus de 3 heures combinées à l’ingestion de breuvages n’allaient pas de pair.
Après s’être essuyé les mains, ceux qui auront trouvé le temps long jusque-là seront amplement récompensés. Rebondissements, révélations, clins d’œil et autres faits d’armes jouissifs; la deuxième partie du film rattrapera le temps perdu et fera feu de tout bois (au sens propre et figuré). Du vrai bonbon! Je ne peux malheureusement vous en dire plus, au risque de vous gâcher des surprises.
Mélange intéressant entre le huis clos tendu de Reservoir Dogs et les excès de Django Unchained, The Hateful Eight nous prouve que le toujours très exalté Tarantino demeure encore aujourd’hui l’un des réalisateurs les plus excitants à suivre.
Avis final aux tech geeks: sachez que le film sera projeté en Ultra Panavision 70 dans seulement deux salles au Québec, soit les cinémas Quartier Latin et Banque Scotia. Vous savez ce qu’il vous reste à faire! Moi, en tout cas, je sais où je serai le 25 décembre prochain.
L'événement en photos
Par The Weinstein Company et www.facebook.com/thehatefuleightmovie
L'avis
de la rédaction