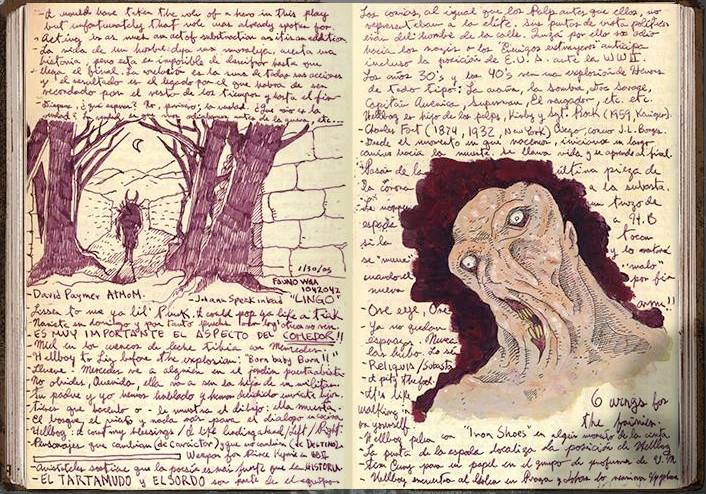Cinéma
Crédit photo : The Criterion Collection
Je l’avoue, j’attendais la sortie de Crimson Peak (en salles depuis vendredi) avec une impatience quasi-enfantine depuis l’annonce officielle de sa production il y a plus d’un an. Bien que la critique soit partagée à son égard, l’engouement général qu’a suscité ce film se justifie sans peine. Écrit juste après la parution de l’inoubliable El Laberinto del Fauno (Le Labyrinthe de Pan), grâce auquel l’œuvre du cinéaste mexicain s’est élevée au niveau de culte, il aura fallu presque dix ans à celui-ci pour mener à terme ce précieux projet qu’il décrit comme étant une romance gothique plutôt qu’un film d’horreur. Quoi qu’il en soit, là n’est pas le sujet de ma chronique «Le baptême de…»!
Les premières ébauches de l’univers fantastique de Guillermo del Toro remontent à sa tendre enfance, alors qu’il vivait à Guadalajara, au Mexique, où il a été élevé par sa grand-mère Josephina. Fervente catholique, elle l’emmène à l’église tous les dimanches et lui inflige une terrible phobie du purgatoire et de l’enfer, l’exorcisant même à deux reprises, horrifiée par les monstres qu’il ne cessait de dessiner dans ses cahiers.
À elle seule, cette anecdote suffit pour mieux saisir le contexte singulier du développement de Del Toro en tant que créateur. Or, sa carrière débute véritablement quand il s’inscrit à l’école professionnelle d’effets spéciaux de feu Dick Smith, artiste-maquilleur légendaire que l’on surnommait «The Godfather of Makeup» et dont l’œuvre inclut les films The Exorcist (1973), Taxi Driver (1976), Amadeus (1984) et, vous l’aurez deviné, The Godfather (1972). Une dizaine d’années plus tard, Guillermo Del Toro donne enfin naissance à son tout premier long-métrage, Cronos, qui le propulse rapidement sous les feux de la rampe en remportant le Grand prix de la critique lors de la 46ème édition du festival de Cannes en 1993.
Dès sa séquence d’introduction, Cronos reflète déjà la connexion presque innée de son réalisateur au genre fantastique. L’esthétique hyper minutieuse qui lui est propre ne fait jamais relâche dans ce conte sinistre racontant l’infortune d’un antiquaire sans histoire (Federico Luppi) qui découvre, dissimulé à l’intérieur d’une statuette d’archange, un étrange loquet en forme de cafard dont les propriétés mystérieuses procurent à son hôte la vie éternelle. Évidemment, l’immortalité a un prix: retrouvant peu à peu sa vigueur d’antan, le vieil homme développe au même rythme une soif de sang irrépressible et une intolérance de plus en plus accablante à la lumière du jour.
Mettant aussi en vedette Ron Perlman (Hellboy) et Claudio Brook, Cronos est truffé d’iconographie religieuse, mythologique et occultiste, mais il ne s’agit pas pour autant d’un film de vampires conventionnel. L’inhérente bonté de son protagoniste l’éloigne considérablement de la figure vampirique vorace, stoïque et sexualisée à laquelle on s’attend normalement, une caractéristique typique de la filmographie de Guillermo del Toro, où le monstre s’avère souvent bien moins malveillant que l’homme. Cette idée s’exprime également par sa mise en scène récurrente d’enfants comme personnages principaux.
D’ailleurs, Cronos n’échappe pas à ce motif : le personnage d’Aurora, la petite-fille de l’antiquaire, y tient un rôle clé. Vecteur par excellence du fantastique en tant qu’exutoire, l’enfance est toujours empreinte d’une fascination naïve devant ce qu’un adulte perçoit comme abject, comme effrayant. Ainsi, Guillermo del Toro n’est qu’un éternel enfant, et c’est probablement à cela qu’il doit son succès… monstre.
Mon coup de cœur par Guillermo del Toro: «The Devil’s Backbone» (2001), avec Marisa Paredes, Eduardo Noriega et Federico Luppi.