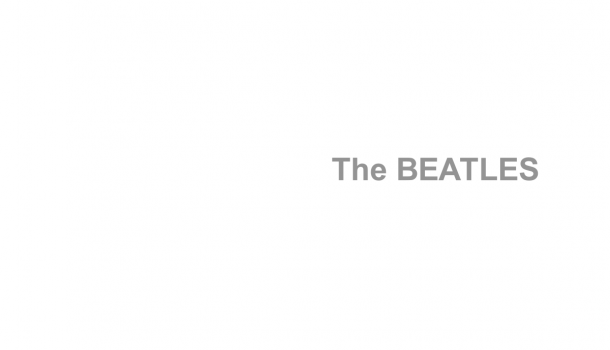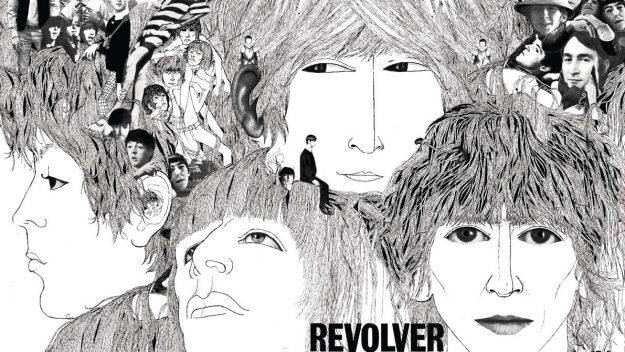MusiqueLes albums sacrés
Crédit photo : www.facebook.com/thebeatles
De toutes les chroniques que j’ai écrites depuis quatre ans, c’est celle où je pourrais sans doute écrire le plus de mots, tant pour l’importance culturelle du disque ou bien l’analyse de ses trente chansons. Tout ce qui tourne autour de l’Album blanc est mythique, de l’expérimentation cacophonique de «Revolution 9» à la brutalité de «Helter Skelter». On a l’impression que chaque pièce peut basculer dans le chaos, le tout accentué par une réalisation plus crue de George Martin.
Comme d’habitude, les Beatles réussissent à chroniquer l’époque sans trop se forcer. Alors que Rubber Soul brisait une certaine naïveté, que Revolver ouvrait tout un monde de possibilités, que Sgt. Peppers semblait laisser croire que tout était permis, l’Album blanc, lui, annonce une cassure. La rupture est au sein du groupe, certes, mais elle est aussi partout ailleurs, dans un climat sociopolitique où une «majorité silencieuse» élit Richard Nixon à la Maison-Blanche, où les Soviétiques mettent un terme au Printemps de Prague, où l’Église catholique se dresse encore contre la régulation des naissances et où Martin Luther King Jr. se fait assassiner. Bref, en 1968, ça pète de partout.

«Back In the U.S.S.R.», malgré son clin d’œil évident à la pop des Beach Boys, est plus rude et musclée que tout ce qui se trouvait sur Sgt. Peppers, l’album précédent. «Dear Prudence» est superbe, mais, avec ses thèmes d’isolement et de réclusion, elle apporte un ton plus introspectif. Bon Iver s’en est sans doute inspiré pour «Holocene». D’ailleurs, Lennon attaque une partie de ses fans sur «Glass Onion», c’est-à-dire ceux qui aiment essayer de trouver un sens caché à ses chansons. «Well here’s another clue for you all / The walrus was Paul», plaisante-t-il, cyniquement.
«Ob-La-Di Ob-La-Da» respire la dissension. Malgré toute la joie qu’on y entend, Lennon détestera la pièce de McCartney à un tel point qu’il mentionnera que Paul fait de la musique de grand-mère. «Wild Honey Pie» voit McCartney biduler seul en studio, comme s’il trébuchait sur ses instruments. «The Continuing Story Of Bungalow Bill», espèce de country psychédélique avec du mellotron, est historique, car on y entend pour la première fois une certaine Yoko Ono chanter.
«While My Guitar Gently Weeps» démontre à quel point George Harrison était maintenant devenu un auteur-compositeur accompli. La pièce, avec l’apport d’Eric Clapton à la guitare, est un véritable chef-d’œuvre. «I look at the world and I notice it’s turning / While my guitar gently weeps», commente Harrison, comme s’il observait l’eau qui coule dans un drain. «Happiness Is A Warm Gun» est d’une noirceur évidente, mais aussi d’une complexité ahurissante avec ses nombreux changements de tempos. «Martha My Dear» est la contribution pop-baroque obligatoire de McCartney.
Lennon frôlait souvent avec la dépression et «I’m So Tired» en est un bel exemple. Ses problèmes d’insomnie y sont très apparents. «Blackbird» est l’une des plus belles pièces que McCartney a écrite depuis «Yesterday», le chanteur y allant d’un commentaire touchant sur le mouvement des droits civils américain: «Take these broken wings and lear to fly / All your life / You were only waiting for this moment to arise». Que du beau. «Piggies» est beaucoup plus sarcastique et cinglante, George Harrison s’attaquant aux cochons qui s’empiffrent à pleine gueule. C’est une métaphore, bien sûr.
Dans la liste des chansons les plus sous-estimées des Beatles, «Rocky Raccoon» devrait apparaître, car c’est une incursion fort réussie de McCartney dans l’americana et la musique roots américaine. Même Ringo Starr y va d’une savoureuse contribution, «Don’t Pass Me By», encore une fois fortement inspirée de la country américaine. L’endiablée «Why Don’t We Do It In the Road?» montre les prouesses vocales de McCartney, visiblement en grande forme. À l’opposé, «I Will» est angélique et délicate, sa mélodie nous berçant jusqu’à «Julia», dernière pièce du premier disque, ode à la mère de John Lennon, décédée dix ans auparavant.
Le deuxième disque débute en trombe avec «Birthday», pièce rock énergique et électrique qui détonne sur le reste de l’album, de par sa simplicité drôlement efficace. Son riff de guitare est légendaire. «Yer Blues» est le blues tordu de John Lennon, sa guitare grimaçant de douleur à travers la production sale de George Martin. Ensuite, «Mother’s Nature Son» revient à un son plus intimiste, McCartney y allant encore une fois d’une mélodie éthérée.
L’ambiance change drastiquement avec «Everybody’s Got Something to Hide Except me and My Monkey», où Lennon lâche carrément son fou. Après quatre chansons, le deuxième disque va dans tous les sens, un peu comme les quatre membres du groupe, de plus en plus divisés. «Sexy Sadie» est lancinante et attaque Mahesh Yogi, guru spirituel indien qui aurait fait des avances à Mia Farrow, amie de Lennon. La chanson respire la désolation et la déception.
La tonitruante «Helter Skelter» fait des ravages à chaque fois qu’elle est jouée. Peu importe ce que pouvait en penser Charles Manson, la pièce est une monstrueuse tentative de McCartney d’écrire une chanson plus bruyante que The Who. Mission accomplie. Que Ringo scande «I’ve got blisters on my fingers» à la toute fin ne fait qu’ajouter à la légende la chanson. «Long, Long, Long» est un poignant aveu d’une perte de foi spirituelle par George Harrison.
«Revolution 1» est la première version écrite de la pièce «Revolution», qui sortira en extrait en version plus électrique. Commentaire sociopolitique pacifique de Lennon, qui nous habituera à de tels appels à la paix par la suite. «But if you go carrying pictures of chairman Mao / You aren’t going to make it with anyone anyhow», prévient-il. Bien que McCartney s’inspire beaucoup de la musique traditionnelle américaine plus tôt sur l’album, «Honey Pie» est décidément très britannique, avec ses inspirations music hall. «Savoy Truffle» voit Harrison y aller de sa touche d’humour, où il se moque de la dépendance au chocolat de son ami Clapton et aussi de la chanson «Ob-La-Di Ob-La-Da», qu’il n’aimait visiblement pas lui non plus. «Cry Baby Cry» est une pièce plus folk tirée de la plume de Lennon.
Vient enfin «Revolution 9», où l’influence avant-gardiste de Yoko Ono est à l’avant-plan plus que jamais. Collage bâti autour d’une mélodie piano jouée par John Lennon, l’œuvre de plus de huit minutes est une représentation sonore d’une révolution imaginaire. Inclure une pièce aussi abstraite et hors norme au sein d’un de leurs albums montre à quel point les Beatles ne se contentaient pas de rester dans la formule et à quel point ils étaient désireux de repousser les limites. En fermeture de rideau, la merveilleuse «Good Night», chantée par Ringo, nous envoie au pays des rêves, tout doucement.
En ce cinquantième anniversaire, beaucoup de lignes s’écrieront sur The Beatles. Bien entendu, les éloges sont mérités, car rares sont les albums qui auront autant marqué l’imaginaire des gens. De sa pochette simpliste et légendaire aux histoires entourant les chicanes de plus en plus présentes au sein de la formation, tout ce qui entourera l’album sera magnifié. Hormis tous ces cancans, on y retrouve encore une fois des artistes au sommet de leur art avec un grand A. La plus grande force de l’Album blanc sera de rendre l’incohérence cohérente, le brouillon ordonné et inégal, mais jamais inégalé. Et ça, presque personne d’autre n’aurait pu le faire.
Ils auront encore un autre album majestueux à livrer. On s’en reparle l’an prochain.