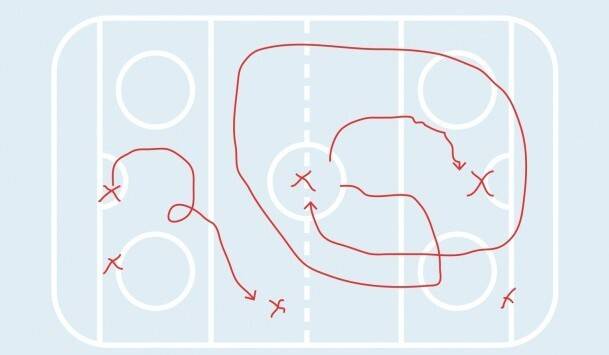LittératureRomans québécois
Crédit photo : Québec Amérique
Comme au théâtre, Marie Laberge fait ici appel aux forces et aux faiblesses du langage familier; mais contrairement à la réalité de la scène qui doit se limiter à offrir le portait d’un moment d’incompréhension, parfois brutal, le roman offre la possibilité d’une évolution. Et cette tentative d’acceptation de la vie, malgré l’absence, s’étale ici sur plus de 15 ans. Les lecteurs assistent donc aux indénouables remises en question de proches qui se sentent abandonnés par le mort en se demandant si, à leur manière, ils ne devraient pas se sentir responsables de l’avoir d’abord abandonné à sa secrète souffrance.
De telles crises existentielles entre des êtres qui s’aiment supposent plusieurs retours sur ses pas, sur ses souvenirs. On ne peut blâmer Laberge d’avoir fait place à cette lutte contre le temps et l’impuissance qui s’exprime par des redites, ni même de présenter un univers où la démarche vers l’acceptation s’essouffle parfois plus vite chez certains. Son rôle d’observatrice fidèle semble toutefois être mis en péril par sa tendance, peut-être malgré elle, à se révéler plus sévère envers la manière de certains personnages d’échapper à leur détresse.
En effet, malgré la tendance à l’autocritique des deux survivants sur lesquels se centre le roman, il est quasi impossible de lire leurs propos sans sentir un regard bienveillant. En revanche, quelques personnages féminins ont droit à plus d’acharnement: elles sont associées à la crainte, à la fuite et même à une folie presque méritée. Le roman aborde avec force et finesse plusieurs éléments du deuil, bien sûr, mais il serait peut-être parvenu à troubler encore davantage si la narration avait su éviter de départager ainsi le bon grain de l’ivraie pour laisser plutôt le lecteur se confronter aux tentatives, même futiles, de chaque personnage pour échapper à sa peine.
Il faut reconnaître quand même à Marie Laberge son maniement intelligent des mécanismes permettant au mort de briller par son absence, par la présence d’un fils dont le tempérament rappelle celui du père et par les réflexions, souvent silencieuses, des proches au contact les uns des autres. Ainsi l’attente de celui qui ne peut pas revenir devient, contre toute espérance, dynamique.
Cette grande auteure n’aura donc pas su faire abstraction de ses propres démons au moment de prendre la plume. Elle est parvenue, en revanche, à trouver des mots pour une douleur profonde, pour laquelle la quête de l’oreille ou du regard qui saura l’apaiser est souvent semée d’embûches. Et par ces mots éveillés, nos propres deuils tendent à s’adoucir aussi.
«Ceux qui restent» de Marie Laberge, Éditions Québec Amérique, 29,95 $.
L'avis
de la rédaction