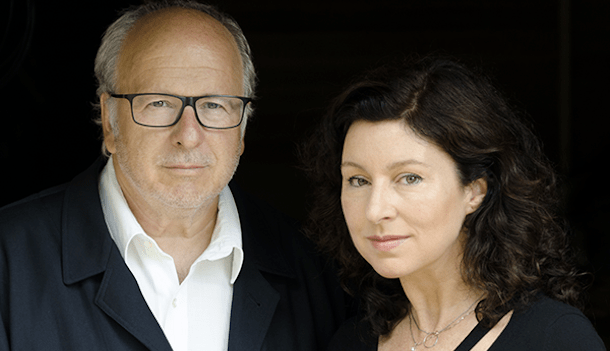ThéâtreCritiques de théâtre
Crédit photo : Yves Renaud
Dans l’obscurité, avant même le lever du rideau, les murmures entremêlés laissent présager la tension qui règne au château:
– Vous sortiez?
– Je descendais.
– On entre par en bas.
– Je viens d’en haut.
– Je pars, adieu.
– Vous aussi?
– Où allez-vous?
– Montons.
– M’élever de la terre.
– Montons.
– Adieu donc. […]
D’entrée de jeu, le texte établit les relations entre les reines dans un décor où les mouvements d’ascension et de descente constituent les principaux déplacements scéniques.
Le metteur en scène Denis Marleau, avec qui nous avons récemment eu la chance d’échanger au sujet du spectacle, s’est d’ailleurs associé avec les mêmes acolytes qu’en 2005, à savoir Michel Goulet à la scénographie, et Stéphanie Jasmin à la conception vidéo.
Une scénographie digne d’une toile d’Escher
En images, les rafales soufflent sur une tour de Londres. Le sifflement du vent s’insinue sournoisement, laissant planer un froid funèbre.
Les escaliers et les paliers évoquent spontanément chez moi la toile Relativité de Maurits Cornelis Escher: des escaliers vertigineux où les relations de pouvoir se dressent entre ces femmes, dont le destin peut basculer à tout moment dans le vide abyssal d’une cave obscure.
La scène ressemble en fait à un échiquier où des pions polychromes, les reines, se donnent la réplique avec ardeur, dans une langue à la fois poétique et rythmée.
Les costumes, qui ont été conçus par la directrice artistique et codirectrice générale du Théâtre ESPACE GO, Ginette Noiseux (j’ignorais qu’elle avait ce talent!), contrastent avec un drame latent, avec une mise en scène statique et frontale.
Des costumes flamboyants pour raviver un drame impénétrable
Ainsi, les robes amples propres à l’esthétique du XVe siècle jouent dans une palette de couleurs vives, d’où une certaine symbolique émane. La reine Élisabeth, campée par la divine Kathleen Fortin, est drapée de la tête aux pieds d’un vert émeraude, bercée par l’espoir de conserver sa couronne. Sa successeure Anne Warwick, interprétée par Sophie Cadieux, incarne la perversion sanguinolente dans sa robe rouge cramoisi tirant sur le rose naïf, prête à offrir les enfants d’Élisabeth en pâture à Richard III pour accéder au pouvoir.
Sous sa candeur et son timbre de voix enfantins, s’acharnant à répéter qu’elle n’a que 12 ans, Anne Warwick est décidément la plus dangereuse des femmes.
Quant à sa sœur Isabelle Warwick, campée par une Céline Bonnier méconnaissable et vêtue d’un jaune aurore, elle demeure discrète et plus en retrait. S’accroche-t-elle à un optimisme dérisoire lorsqu’elle tente de nier en bloc la mort de son époux George?
Dans sa robe bleu royal, Marguerite d’Anjou, pour sa part, est cynique, même si l’Histoire nous indique qu’elle a défendu le parti des Lancastre pendant la guerre des Deux-Roses avec un courage notoire. Dans ce rôle, Monique Spaziani nous décroche quelques rires avec son monologue ironique sur l’agonie du roi Édouard. Ses allusions à la Chine et à son prétendu départ imminent vers cette destination nous la rendent fort sympathique. Elle a du mordant, tout en incarnant un calme serein.
Enfin, la duchesse d’York (interprétée avec justesse par Sylvie Léonard), que l’on surnomme l’orgueilleuse Cécile Neville, mère de Richard III, est d’une intransigeance à glacer le sang envers sa fille Anne Dexter, l’impressionnante Marie-Pier Labrecque.
L’histoire raconte qu’à la suite d’un amour presque incestueux entre Anne et son frère George, leur mère aurait fait trancher les mains d’Anne, la coupant de tout lien maternel.
Des personnages qui sortent de l’ombre pour embrasser la lumière
Si le personnage d’Anne Dexter est plutôt invisible dans les écrits de Shakespeare, Normand Chaurette, avec cette pièce, lui redonne une parole déconcertante. Interprété par une Marie-Pier Labrecque désarmante, le personnage, sous ses haillons beiges et sa capine, s’extirpe de son mutisme avec aplomb.
Comme une ombre au tableau, muette et effacée lors des dialogues entre ses consœurs, elle prend la parole avec âpreté, escamotant les mots comme si elle avait été réduite au silence trop longtemps. Elle se meut de tout son corps sur le sol. On dirait le personnage le plus en chair et pourtant le plus invisible dans l’œuvre de Shakespeare.
Le personnage d’Élisabeth Woodville, incarné par Kathleen Fortin, est de loin mon coup de cœur. Elle est rafraîchissante, spontanée, drôle. Elle entre en scène suite au monologue de Marguerite d’Anjou. Après la morosité, l’écervelée s’écrie: «Il vit. Il vit!». Heureusement, ce personnage plus léger détrône une certaine monotonie.
Non pas que la pièce est ennuyante, bien au contraire, mais il faut s’armer d’une solide concentration et d’une grande ouverture au classicisme. On plonge difficilement dans la langue de Chaurette, mais dès qu’on en saisit toute la poésie, on se laisse séduire et porter.
Une brève recommandation
Toutefois, inclure un schéma de la généalogie des personnages dans le programme serait d’une aide précieuse pour s’y référer. Je crois également que les publications du TNM, disponibles sur leurs réseaux sociaux, pourraient grandement aider les spectateurs à se faire une tête au sujet des six reines. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de s’initier à la guerre des Deux-Roses et à la hiérarchie des deux familles royales, les Lancastre et les York.
En somme, Les reines est une pièce intéressante pour la place qu’elle accorde aux figures féminines, mais difficilement accessible en raison de la genèse historique de l’œuvre et d’une écriture théâtrale somme toute classique qui requiert une attention particulière aux nuances et aux intentions des personnages. Il n’en demeure pas moins que ce texte est sublime et ces décors grandioses malgré leur austérité. Encore faut-il être un public averti, car l’enchaînement des événements peut être dur à suivre pour les non-initiés.
«Les reines» de Normand Chaurette en images
Par Yves Renaud
L'avis
de la rédaction