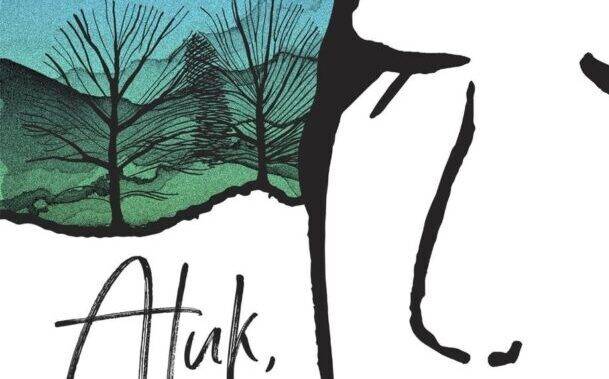ThéâtreCritiques de théâtre
Crédit photo : Yves Renaud
Dès les premiers regards échangés, ils s’éprennent l’un de l’autre. Animée d’un désir de liberté, Almanda l’épouse dans l’empressement de leur passion, embrasse sa culture et intègre avec détermination le style de vie nomade.

Photo: Yves Renaud
Migrer au rythme des saisons
Une scénographie transcendante
C’est déchirant, mais surtout révoltant.

Photo: Yves Renaud
Transposer le territoire sur la scène
La metteure en scène Émilie Monnet réussit avec brio à transposer la poésie de l’œuvre à la scène, notamment grâce à une mise en scène ponctuée de rites, de mythes et de chants en innu-aimun accompagnés du bruit des tambours.
Et l’adaptation du roman à la scène, elle?
Bien que le texte original ait dû être synthétisé pour les besoins de ce spectacle, beaucoup de temps a été accordé à la rencontre amoureuse entre Almanda et Thomas, et trop peu à la description du territoire, bien qu’on le voit sur les archives vidéo dans toute sa splendeur.
C’est cette transition qu’il manque au spectacle à mon humble avis.
La distribution, quant à elle, est fort convaincante. Léane Labrèche-d’Or porte sur ses épaules un rôle costaud, et on sent bien qu’elle a dû s’imprégner elle-même du territoire pendant les répétitions, de la charge mentale et physique qu’implique la vie nomade, ne serait-ce que les mouvements de migration constants.
Dans le rôle de Christine, la sœur de Thomas, Sharon Fontaine-Ishpatao est réellement attachante et drôle, notamment dans cette scène durant laquelle elle enseigne à Almanda les nombreux termes visant à désigner la neige en innu-aimun, ou encore lorsqu’elle lui explique la différence entre les épines d’un sapin et d’une épinette! Ces moments, tendres et remplis d’humour, illustrent bien l’intégration de la Canadienne française, qui commence à tranquillement s’imprégner de leur culture.

Photo: Yves Renaud
Jean Luc Kanapé, dans le rôle de Malek, ne laisse pas sa place avec des partitions uniquement en langue innue, lesquelles sont traduites à l’aide de surtitres. C’est vraiment le chef qui veille sur le clan Siméon avec son air impassible, mais d’une manière si attendrissante. Quant à son fils Thomas, joué par Étienne Thibeault, force est d’admettre qu’il se dégage de l’acteur un charme incandescent devant lequel on brûle de découvrir la richesse de la culture innue.
Kukum témoigne de la sédentarisation forcée des Innus, de la destruction de leurs territoires, et des abus commis sur leurs enfants. Surtout, cette création redonne une place indispensable et légitime à la communauté autochtone sur une des plus belles scènes théâtrales montréalaises.
Pour ma part, j’ai été habitée par cette adaptation pendant des jours, à idéaliser le mode de vie du peuple innu, à envier leur culture si riche, à ressentir une envie irrépressible de lire l’œuvre entière de Michel Jean, à m’initier à la musique d’artistes autochtones, notamment à celle de Laura Niquay, dont le nom m’était familier, mais sans plus.
C’est ce qu’on appelle faire œuvre utile après tout.
La pièce «Kukum» au TNM en images
Par Yves Renaud
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
 Photo: Yves Renaud
Photo: Yves Renaud -

-

-
 Photo: Yves Renaud
Photo: Yves Renaud -
 Photo: Yves Renaud
Photo: Yves Renaud -

-

L'avis
de la rédaction