LittératureL'entrevue éclair avec
Crédit photo : Ben Addou Idrissi Youness
Soufiane, on te connaît notamment comme journaliste, écrivain, chroniqueur et scénariste. On est curieux de savoir: d’où t’est venue la piqûre pour l’écriture?
«Piquer est bel et bien le mot approprié, car piqué je l’ai été, mais secrètement durant mon adolescence. Secrètement parce que je ne donnais forme aux sons que pour moi-même. Cela allait des chansonnettes, aux vers épars, en passant par des bouts de textes sans raison ni destination. D’ailleurs, j’ai toujours sur moi un petit calepin qui me permet de figer les observations et les idées qui ne préviennent pas. Cependant, je n’ai mesuré le réel pouvoir des mots que lorsque j’ai commencé à écrire des lettres en feu à mes amours et mes amoureuses.»
«Ceci dit, rien ne me prédestinait à devenir journaliste ou scénariste et encore moins romancier. Je suis ingénieur de formation et j’ai dû tout laisser tomber pour vivre de ma plume ou du moins essayer (mais ceci est une autre longue histoire), qui plus est dans un pays où cela est considéré par beaucoup, proches ou pas, comme un suicide professionnel.»
«Dix ans plus tard, je suis où je suis, plus pour le meilleur que pour le pire, et sans l’once d’un regret puisque le vrai regret, celui qui blesse profondément l’âme, n’est pas de n’avoir pas réalisé ses rêves, mais de n’avoir pas essayé.»
Sur le Web, on a pu lire que tu appartiens à «la nouvelle génération d’écrivains maghrébins» issus de la francophonie. Y a-t-il un profil particulier propre à ces auteurs et autrices, que ce soit du point de vue du style d’écriture, du ton adopté et/ou des sujets traités au sein de leurs histoires?
«Je ne peux pas parler au nom des autres, donc, ce qui suit n’engage que ma petite personne. Je pense qu’après ce qu’on appelle «le printemps arabe» qu’a connu, entre autres, le Maghreb en 2011, mais qui, in fine, n’a rien de printanier (mais ceci est une autre longue histoire), on a assisté à une vague de nouveaux écrivains et de nouvelles écrivaines qui ont opéré un schisme avec la littérature qui prévalait à l’époque. Leur écriture est plus revendicatrice que leurs prédécesseurs dans la mesure où elle est plus dénonciatrice des inégalités sociales et des maux de leurs sociétés qui, à mon goût, se cherchent encore.»
«D’un autre côté, je pense que le fait que la censure frappe encore la majorité de ces pays, voire qu’elle s’est durcie après les «révolutions» arabes, a poussé certains jeunes, qui ont la fibre militante, à trouver dans le roman un bon prétexte pour révéler les injustices qui rongent leur quotidien. Après tout, le roman est fictif, par conséquent, qui peut condamner, légalement du moins, ces auteurs et autrices pour avoir dénoncé l’imaginaire… n’est-ce pas?»
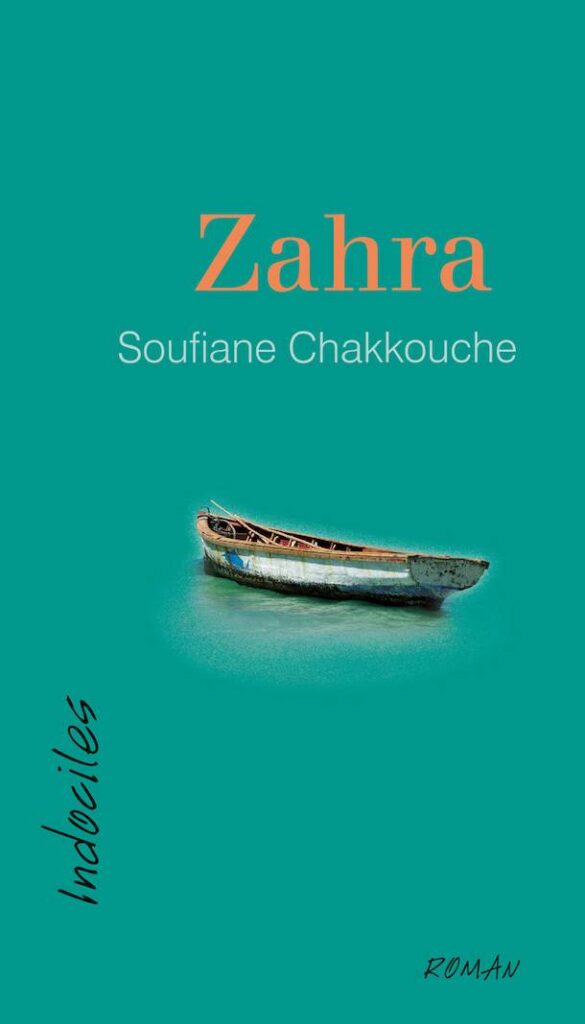
Le 23 février, ton livre Zahra est paru aux Éditions David. Dans cette histoire, tu t’intéresses «au sort de ces “petites bonnes” issues du Sud marocain qui sont traînées de force dans de riches familles de Casablanca et s’y trouvent à la merci du maître des lieux». Pourquoi as-tu souhaité parler de ce sujet en particulier, et d’où t’est venue l’inspiration pour ce livre?
«En effet, je raconte, dans Zahra, le parcours d’une enfant, Oumaya qui a été, misère oblige, cédée par ses parents contre un salaire aussi misérable que leur condition de vie à une riche famille de Casablanca, et ce, afin d’y travailler en tant que «petite bonne» à tout faire.»
«Au Maroc, ce phénomène existait et existe encore malgré une législation qui a vu le jour ces dernières années – les injustices ont souvent la peau dure. Je me rappelle pendant mon enfance qu’il n’était pas rare d’être invité chez un proche et de trouver une «petite bonne» en train de faire le ménage ou de servir les convives à table. Un enfant qui se fait servir par un enfant du même âge, cette image m’a poursuivi pendant longtemps avant de finir par me hanter, littéralement. La seule manière de s’en débarrasser était de la vomir dans un récit. D’ailleurs, cette scène existe dans ce livre.»
«Néanmoins, je tiens à signaler que Zahra raconte également l’histoire de deux autres destinées aussi importantes dans la trame narrative de ce roman; j’ai même osé parfois des moments de joies!»
Auparavant, tu avais publié deux romans policiers, L’inspecteur Dalil à Casablanca et L’inspecteur Dalil à Paris. Qu’est-ce qui t’a donné envie d’explorer un genre littéraire différent avec Zahra?
«À question directe réponse franche. De ce pas, je suis dans l’obligation de vous avouer que l’explication d’une telle entorse à «la règle» réside dans cette même «règle», autrement dit, c’est le fruit d’une folie intérieure! En effet, je tiens en horreur les cases depuis toujours et, la peur bleue d’être prisonnier dans l’une d’elles, celle «d’écrivain de polar», m’a poussé à explorer un autre «genre» littéraire qui me tient à cœur.»
«Pour tout vous dire, j’ai commencé l’écriture de Zahra avant mon deuxième roman, L’inspecteur Dalil à Paris, et cela m’a pris cinq ans pour l’achever. Beaucoup d’auteurs de polar avant moi et plus talentueux que moi ont eu cette phobie et/ou ont souffert de cette fameuse case. Le plus célèbre d’entre eux est Sir Arthur Conan Doyle (père de Sherlock Holmes) qui considérait, jusque sur son lit de mort, que sa meilleure œuvre n’était pas un polar, mais un roman historique nommé La Compagnie blanche. Or, ce livre n’a pas rencontré le succès escompté auprès du public à cause, justement, de cette étiquette d’«auteur de polar». Seules les aventures de Sherlock Holmes comptaient aux yeux de la plupart de ses lecteurs.»
«En résumé, je ne limiterai jamais mes inspirations et/ou mon imagination pour la simple raison que mon seul juge est mon lecteur. L’essentiel dans tout cela, c’est que ce dernier apprécie ce que j’écris, et peu importe les genres, peu importe les cases.»
Quels sont tes prochains projets pour 2021 ? On aimerait savoir si tu comptes te lancer dans l’écriture d’un nouveau livre et, si oui, quels en seront le thème et le genre littéraire!
«L’année 2021 peut s’avérer riche pour moi, à condition, toutefois, de ne pas s’abandonner à mon sport favori, la paresse. Concrètement, je suis actuellement en train d’écrire mon troisième roman policier, L’inspecteur Dalil à Beyrouth (qui me donne du fil à retordre), dont la sortie est prévue pour la fin de l’année.»
«Aussi, l’ossature d’une histoire dont les événements se passent au Canada commence à se dessiner clairement dans ma boîte crânienne. Je pense que je vais débuter très prochainement l’écriture de ce roman à mille lieues du milieu du polar. Il s’agit de l’histoire d’une chaise (l’affaire est on ne peut plus sérieuse).»
«Parallèlement, je coécris en ce moment les scénarios de deux longs métrages (cinéma), l’un avec l’acteur et réalisateur marocain, Fehd Benchemsi et l’autre avec le réalisateur ontarien, Joffrey Saintrapt. Y’a du boulot!»
















